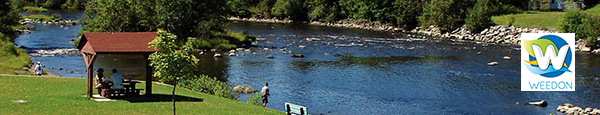André (père) et Alex (fils) Vézina sont passionnés et cherchent à repousser les limites du possible pour offrir des produits haut de gamme innovants sur mesure.
Artisanex, cette entreprise de chez nous spécialisée en ébénisterie, située à East Angus, a le vent dans les voiles. L’équipe de direction André et Alex Vézina, appuyée d’employés chevronnés, cherche quotidiennement à repousser les limites du possible afin d’offrir des produits innovants, élégants et fiables.
Lancée en 2017, l’entreprise n’a pas tardé à se faire un nom, une réputation ainsi qu’une notoriété reconnue à l’ensemble du Québec. La présentation de ses produits dans les revues spécialisées et passage à des émissions de télévision la placent à l’avant-plan dans le domaine.
L’entreprise se spécialise dans les produits haut de gamme sur mesure, cabinets de cuisine, vanités de salle de bain, foyers, bibliothèques, en fait tout ce qui est meuble intégré. « Tout ce qui peut être entrepris, on le fait. Il n’y a rien qu’on ne fait pas », de lancer André Vézina sous le regard approbateur de son fils Alex.
Tous deux, père et fils, de La Patrie, ont lancé l’entreprise en 2017 dans les anciens locaux de Menuiserie Côté, Avenue de la Tuilerie à Westbury. Il a suffi que deux ans pour que les carnets de commandes forcent l’entreprise à se relocaliser dans un espace plus grand à East Angus.
Contacts
Leur succès, l’entreprise le doit à l’efficacité de l’équipe d’employés, à la qualité du produit, du service personnalisé et bien entendu à des contacts. « J’ai suivi un cours de designer à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ma professeure était Mélanie Rousseau et ça bien cliqués entre nous deux. On a créé un contact et à partir de là, on a été mis en contact avec des designers », d’exprimer Alex. Émilie Caretti, chroniqueuse et designer, est l’une qui a permis à l’entreprise locale de se faire connaître. D’ailleurs, Artisanex collabore en étroite collaboration avec les designers qui travaillent en même temps de pair avec les clients pour créer un projet unique qui répondra à leurs aspirations. « Les designers ont des idées spéciales. C’est du cassage de tête, mais on n’a jamais refusé un projet. On a tout le temps trouvé une solution, une façon de faire ce qu’ils voulaient », d’exprimer André avec le regard approbateur d’Alex. Les propos tenus par le père et le fils reflètent une fierté évidente de leur production. Ils précisent compter sur une équipe professionnelle et efficace.
Les résultats sont probants et à toute évidence répondent aux exigences de designer. D’ailleurs, ceux-ci leur rendent bien. L’entrepris a fait des pleines pages dans certaines revues spécialisées comme Les idées de ma maison, Je décore les plus belles cuisines du Québec et Canapé. Elle peut s’enorgueillir d’avoir fait des apparitions sur des chaînes de télévision spécialisées comme Casa pour l’émission L’envers du décor et Les idées de grandeur. En avril prochain, l’entreprise locale se retrouvera à l’émission Vendre ou rénover, diffusé sur les ondes de Canal Vie. Évidemment, tout ça contribue à mousser la notoriété de l’entreprise et cela se traduit par un carnet de commandes bien rempli qui mène jusqu’en février 2024. Volontairement, on ne va pas plus loin par souci de s’assurer de bien respecter les délais de livraison. Outre la fabrication, une équipe d’Artisanex effectue la livraison et l’installation des produits selon les exigences des clients. Alex insiste pour dire « on mise sur la qualité de nos produits et sur le service. On envoie des plans détaillés pour approbation au client et une date de livraison. On essaie de faire un suivi serré sur les échéanciers. Notre vision est axée sur le service aux clients. »
Marché
L’ensemble du marché d’Artisanex se situe sur l’île et la grande région de Montréal à la hauteur de 60 %. Une portion de 35 % se retrouve du côté américain et 5 % en région. Les responsables entendent mousser le marché local et pour y arriver, on ouvrira, si ce n’est déjà fait, une salle de montre accessible sur rendez-vous. Mais ce portrait pourrait changer au cours des prochains mois. Les propriétaires souhaitent développer davantage la région de la Montérégie et particulièrement le marché ontarien en ciblant Toronto.
Investissement
André et Alex n’ont pas l’intention de lésiner et se donnent les moyens de leurs ambitions. Un important projet d’investissement de 2,1 millions de dollars est sur le point de se réaliser. Cela comprendra un agrandissement de 7 500 pieds carrés qui portera la surface actuelle à 22 500 pieds carrés. On profitera de l’occasion pour optimiser la salle de peinture, faire l’acquisition d’un four pour la cuisson de la peinture et ajouter une seconde machine à contrôle numérique dernier cri. Les propriétaires tiennent à souligner le travail de Chantal Ramsay, conseillère aux entreprises, du CLD du Haut-Saint-François, pour son appui au projet.
Pour ces passionnés, l’investissement à venir n’est qu’une étape dans l’évolution de l’entreprise et leur objectif est de constamment repousser les limites. Ils carburent aux défis « on va de l’avant », d’exprimer Alex. D’ailleurs, ils sont fiers de préciser qu’ils comptent sur une excellente équipe d’employés alliant deux générations; celle regroupant des employés (ébénistes) entre autres d’expérience et la génération de concepteurs numériques. Artisanex, ce sont des travailleurs passionnés en quête de défis, prêts à repousser les limites du possible.