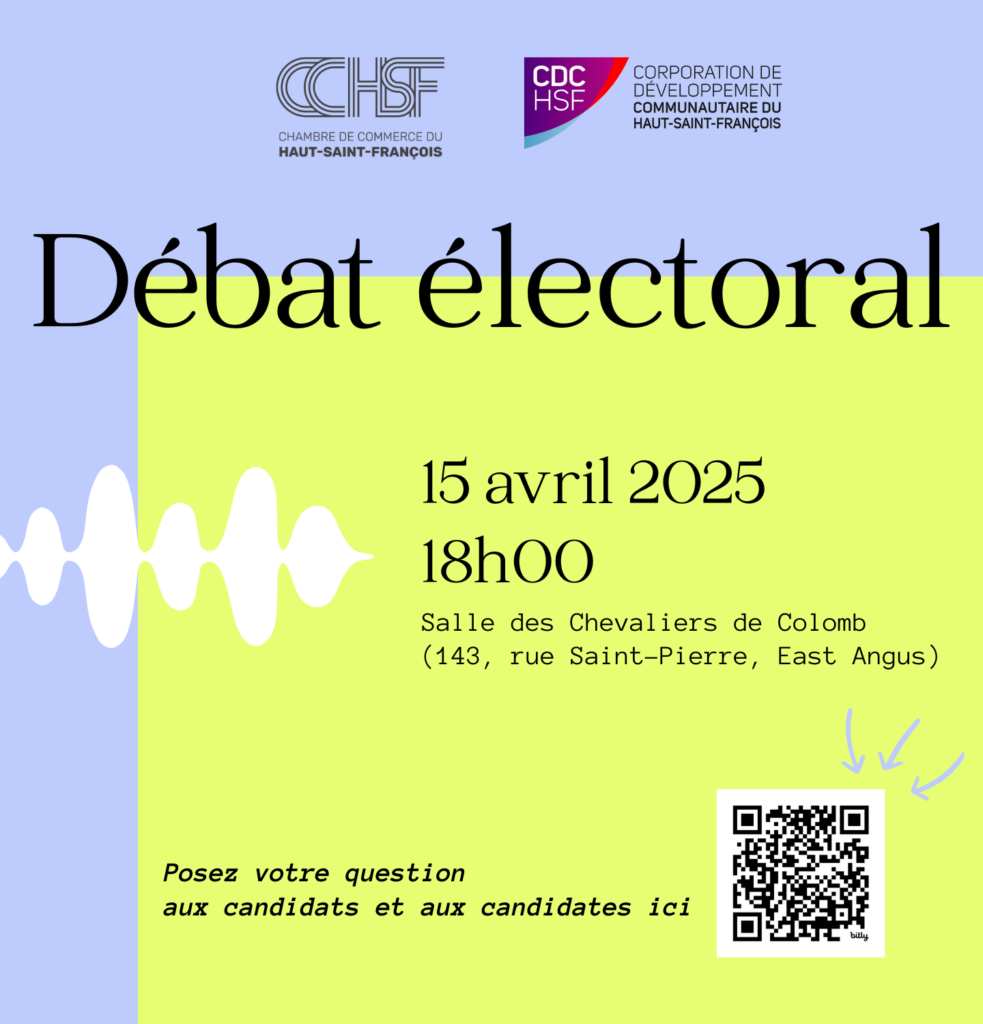Scène traditionnelle qui va rappeler bien des souvenirs aux plus vieux.
Les cultivateurs et les bûcherons qui n’avaient que quelques arpents de boisé il y a des années de ça n’en reviennent pas lorsqu’ils visitent les industries acéricoles d’aujourd’hui. De l’acier inoxydable, des machines à faire l’osmose, des bouilloires grandes comme leur étable, des réservoirs quand ce ne sont pas des silos, puis de la tubulure, des kilomètres de tuyaux noir ou bleu ou vert qui relient les érables au bâtiment industriel, tout ça les épate.
L’acériculture traditionnelle survit encore dans quelques cabanes. Elles sont conservées comme des musées. C’est tant mieux parce qu’elles représentent ce dur travail printanier qui ajoutait quelques dollars au porte-monnaie toujours mince.
Les chaudières en acier et les goutterelles (goudrelles, gouges, chalumeaux) fichées dans l’arbre, le cheval qui tire la « tonne » d’eau d’érable, le gars avec ses deux contenants de cinq gallons qui marche dans la neige épaisse en raquette et qui essaye de ne pas trop renverser du précieux liquide, la cabane fabriquée de planches récupérées avec son toit en deux pignons d’où sortait la vapeur du « champion » chauffé au bois, tout ceci n’existe que dans le folklore au même titre que les légendes de « Gros jambon », d’Alexis le Trotteur, de Jos Monferrant, et des bûcherons aux Rapides de Joachin, de la drave, des « slouces » et des mineurs noirs de poussières de charbon.
Le gars au printemps, habillé d’une chemise carreautée, les manches retroussées, portait de grosses culottes d’étoffe verte détrempée du matin au soir. Ses bottes s’étaient remplies de neige dès la première tournée des érables. Il ouvrait les portes du champion pour y enfourner des bûches pour que « ça bouille ». De ses pantalons se dégageait alors un nuage de vapeur qui allait joindre celle de l’évaporateur.
Ce même type était tout content de recevoir la visite de la parenté la fin de semaine, parce que la « visite », c’était des bras tout frais qui allaient se charger de faire la tournée des érables, moyennant un bel apport de tire sur la neige à leur retour. Et pour ce cultivateur, la vente de son sirop dans des gallons de verre représentait un revenu d’appoint non négligeable. Fier comme un coq, il n’offrait pas du « sirop de poteau ». C’est ce que disaient les mauvaises langues quand elles soupçonnaient qu’il contenait un gros pourcentage de cassonade…
Heureusement ! Les quelques semaines qui étaient consacrées aux sucres, à entailler les érables, à récolter l’eau, à la bouillir du matin jusqu’à la nuit tombée parce qu’il n’y avait pas de réservoir pour l’entreposer, c’était très dur. Certains pour éviter d’attraper une fluxion de poumons réduisaient le « réduit » (une étape avant que l’eau devienne sirop) avec du gros gin. Les papillons arrivés avec la sève signifiaient qu’il fallait « désentailler » et nettoyer l’équipement. Tous ces travaux réalisés dans des conditions très difficiles relevaient d’une discipline olympique.
Que de vocabulaire les Québécois ont créé pour parler des sucres ! On allait aux sucres. Pendant cette saison printanière tombait la bordée des sucres, une tempête de neige formée de gros flocons bien chargés d’humidité qui déboulait densément. C’en marquait le début. Auparavant, on avait « battu les chemins » en passant la grosse « sleigh » (gros traineau articulé sur lequel on empilait les billots). En hiver, on faisait chantier dans l’érablière pour ramasser du veneer (billots de bois francs destinés à devenir feuilles de contreplaqués).
Ça prenait les raquettes pour aller planter les goutterelles dans les érables et y accrocher les chaudières de métal. La mèche du vilebrequin n’était pas toujours bien affilée. Il fallait forcer pour faire l’entaille. On revenait sur ses pas pour compacter au mieux la neige avant d’aller à l’autre érable. Cent fois, cinq cents fois à répéter ce manège pour avoir du sirop au bout « d’la run ».
Quand ça coulait, on attelait le cheval à la tonne, un gros baril de 200 gallons installé sur une partie de la « sleigh » du devant. Pauvre cheval ! J’en ai vu verser avec la tonne quand les chemins devenaient tout défoncés, lorsque la chaleur arrivait. Il fallait le dépêtrer des « menoirs » (limons), ces deux tiges de bois qui relaient le traineau au cheval et qui servaient à la fois pour le faire tourner et qui le retenait grâce à la fessière, cette partie de l’attelage posée sur les fesses du cheval, dans les descentes.
Quand le sirop était prêt, qu’il formait une petite boule sur l’eau glacée, on le transvidait dans des gallons de verre brun, bien content de laisser mourir le feu sous le champion et les pannes à finir. Pourtant, la journée n’était pas terminée. Il fallait descendre à pied ces fragiles contenants jusqu’au bord parce que les placer sur la « sleigh » risquait de les casser.
Quel soulagement, rendu à la maison de se déshabiller pour mettre des vêtements secs et enfin manger un repas chaud et consistant.
Ce récit n’enlève rien au travail des acériculteurs modernes. Eux aussi les ressentent les effets du froid et de la fatigue à la fin d’une journée d’entaillage en raquettes, mais leurs vêtements sont mieux conçus et fabriqués avec de meilleures fibres. L’outillage n’est plus comparable. Il n’est plus saisonnier. Il demande un entretien annuel et de lourdes dépenses. Leurs responsabilités ne sont plus les mêmes. Nous, quand on cassait un gallon de sirop, c’était le drame. Eux vivent avec tout le stress de rentabiliser des équipements qui valent de gros sous. Un bris d’équipement n’a pas les mêmes conséquences pour eux que les nôtres, dans not’ temps. Quoi qu’il en soit, depuis des siècles, on aime ça sucrer le bec des amateurs…